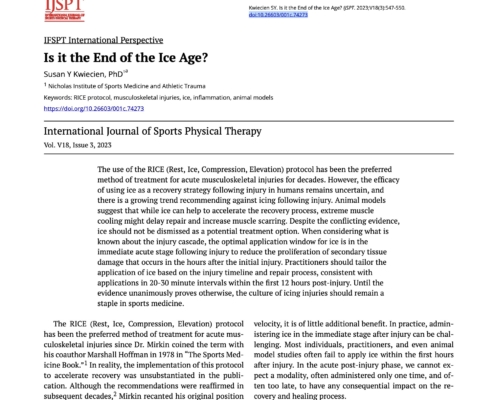Glace, chaleur ou bains contrastes?
Face à une blessure musculosquelettique, une douleur articulaire ou après un effort intense, le choix entre l’application de glace, de chaleur ou l’utilisation de bains contrastes peut sembler complexe. Chacune de ces modalités thérapeutiques possède des mécanismes d’action, des indications et des précautions qui lui sont propres. Comprendre leurs spécificités est essentiel pour une utilisation judicieuse et sécuritaire, visant à optimiser le processus naturel de guérison du corps.
La cryothérapie (thérapie par le froid)
La thérapie par le froid, ou cryothérapie, est le plus souvent recommandée dans les premières 24 à 72 heures suivant une blessure aiguë (entorse, claquage, contusion, tendinite). Son objectif principal est de limiter les dommages secondaires.
Mécanisme d’action : L’application de froid provoque une vasoconstriction (rétrécissement des vaisseaux sanguins) au niveau local. Ce phénomène a plusieurs conséquences bénéfiques en phase aiguë : il diminue le flux sanguin, ce qui aide à contrôler l’hémorragie et la formation d’un œdème (gonflement) (4). Le froid a également un effet analgésique puissant en ralentissant la vitesse de conduction des nerfs responsables de la transmission du message de douleur vers le cerveau. De plus, en abaissant la température des tissus, il réduit leur demande métabolique, ce qui aide à préserver les cellules non encore atteintes par la lésion initiale (4, 5).
L’approche moderne « PEACE & LOVE » suggère d’utiliser la thérapie par le froid avec parcimonie, principalement pour son effet antalgique, car une utilisation excessive pourrait ralentir le processus inflammatoire nécessaire à la guérison (1). Si la douleur est constante, qu’elle trouble le sommeil, gêne significativement la fonction, que la région est rouge, chaude et enflée, vous risquez peu de vous tromper en appliquant de la glace.
Procédure d’application :
- Utilisez un sac de plastique (style Ziploc).
- Pour plus d’efficacité, utilisez de la vraie glace.
- Mettez assez de glace dans le sac de façon à ce qu’il demeure souple, toujours enveloppé dans un linge humide pour éviter les brûlures par le froid.
- Appliquez sur la zone blessée en prenant soin de bien couvrir, pendant 15 à 20 minutes maximum, toutes les 2 à 3 heures.
- Pour une grosse articulation ou une blessure en profondeur, comme un genou ou le dos, il peut-être nécessaire de l’appliquer tout autour et un peu plus longtemps.
- Pour réutiliser le même enveloppement, retirez le surplus d’eau à la fin de la première utilisation. Ajoutez 1 tasse d’alcool-à -riction dans le sac. Remettez-le au congélateur pour utilisation ultérieure.
Précautions et contre-indications : La cryothérapie est contre-indiquée chez les individus souffrant de troubles circulatoires (maladie de Raynaud), d’hypersensibilité au froid (urticaire au froid) ou d’une perte de sensibilité cutanée (neuropathie diabétique). Ne jamais appliquer de glace directement sur la peau ou sur une plaie ouverte.
La thermothérapie (thérapie par la chaleur)
La thérapie par la chaleur est généralement indiquée pour les douleurs chroniques, les raideurs musculaires ou articulaires, et en préparation à un effort. Elle est à éviter sur une blessure aiguë et enflée.
Mécanisme d’action : La chaleur a l’effet inverse du froid : elle provoque une vasodilatation (augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins). Cet afflux sanguin accru apporte plus d’oxygène et de nutriments aux tissus, ce qui peut accélérer les processus de réparation cellulaire dans les phases subaiguë et chronique (6). La chaleur aide également à augmenter l’élasticité des tissus conjonctifs comme les muscles et les tendons, réduisant ainsi la raideur et améliorant la mobilité. Enfin, elle possède un effet relaxant et antalgique en agissant sur certains récepteurs nerveux et en diminuant les spasmes musculaires.
Procédure d’application : Utilisez une bouillotte, un coussin chauffant ou un bain chaud. La température doit être confortablement chaude, mais jamais brûlante. Appliquez pendant 15 à 20 minutes. Une chaleur humide (serviette chaude et humide) est souvent perçue comme plus pénétrante.
Précautions et contre-indications : N’appliquez jamais de chaleur sur une blessure fraîche (moins de 72 heures), enflée ou sur une infection. Elle est contre-indiquée en cas de troubles circulatoires sévères, de troubles de la sensibilité, sur des zones présentant une hémorragie ou sur un site tumoral. Le risque de brûlure est réel, surtout chez les personnes à la sensibilité altérée.
Les bains contrastes
La thérapie par bains contrastes combine les effets du chaud et du froid et est principalement utilisée pour la récupération post-exercice ou pour traiter des conditions subaiguës où la circulation est stagnante (par exemple, une entorse après la phase inflammatoire initiale).
Mécanisme d’action : L’alternance entre l’immersion dans l’eau chaude (vasodilatation) et l’eau froide (vasoconstriction) crée un effet de « pompage » vasculaire. Cette action mécanique est supposée stimuler la circulation sanguine et lymphatique, aidant ainsi à drainer l’œdème et à éliminer les déchets métaboliques tout en favorisant l’apport de sang neuf (2, 3). Donc, cette méthode vise à réduire la douleur et la raideur tout en accélérant la récupération.
Procédure d’application :
- Préparez deux bacs, l’un avec de l’eau chaude (38-44 °C) et l’autre avec de l’eau froide (10-15 °C).
- Commencez par 1-4 minutes dans l’eau chaude, puis passez immédiatement à l’eau froide pour 1 minute.
- Répétez ce cycle 4 à 5 fois, en terminant par l’eau froide.
Précautions et contre-indications : Les contre-indications sont similaires à celles de la chaleur et du froid : troubles circulatoires ou de sensibilité, plaies ouvertes, infections locales.
Mise en garde
Le choix entre glace, chaleur et bains contrastes dépend du type de blessure, de sa chronicité et de l’objectif recherché. Ces modalités sont des outils complémentaires et ne remplacent pas un diagnostic médical. Il est primordial de consulter un professionnel de la santé (médecin, physiothérapeute) pour obtenir une évaluation précise et des recommandations personnalisées avant d’entreprendre tout traitement.
Références
- Dubois, B., & Esculier, J. F. (2020). Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. British Journal of Sports Medicine, 54(2), 72-73. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2019-101253
- Higgins, T. R., Greene, D. A., & Baker, M. K. (2017). Effects of Cold Water Immersion and Contrast Water Therapy for Recovery From Team Sport: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(5), 1443–1460. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001559
- Bieuzen, F., Bleakley, C. M., & Costello, J. T. (2013). Contrast water therapy and exercise induced muscle damage: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 8(4), e62356. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062356
- Algafly, A. A., & George, K. P. (2017). The effect of cryotherapy on nerve conduction velocity, pain threshold and pain tolerance. British Journal of Sports Medicine, 41(6), 365-369. 10.1136/bjsm.2006.031237
- MOHD RADZI, A. A. A. ., & MOHAMAD, M. Y. (2022). EFFECTS OF CRYOTHERAPY AFTER SOFT TISSUE INJURY: A SYSTEMATIC REVIEW. International Journal of Allied Health Sciences, 6(2), 2625–2631. https://doi.org/10.31436/ijahs.v6i2.690
- Petrofsky, J., Berk, L., Bains, G., Khowailed, I. A., Lee, H., & Shah, S. (2017). The Efficacy of Sustained Heat Treatment on Delayed Onset Muscle Soreness. Clinical Journal of Sport Medicine, 27(4), 329–337. https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000000375

Glace, chaleur ou bain contrastes?